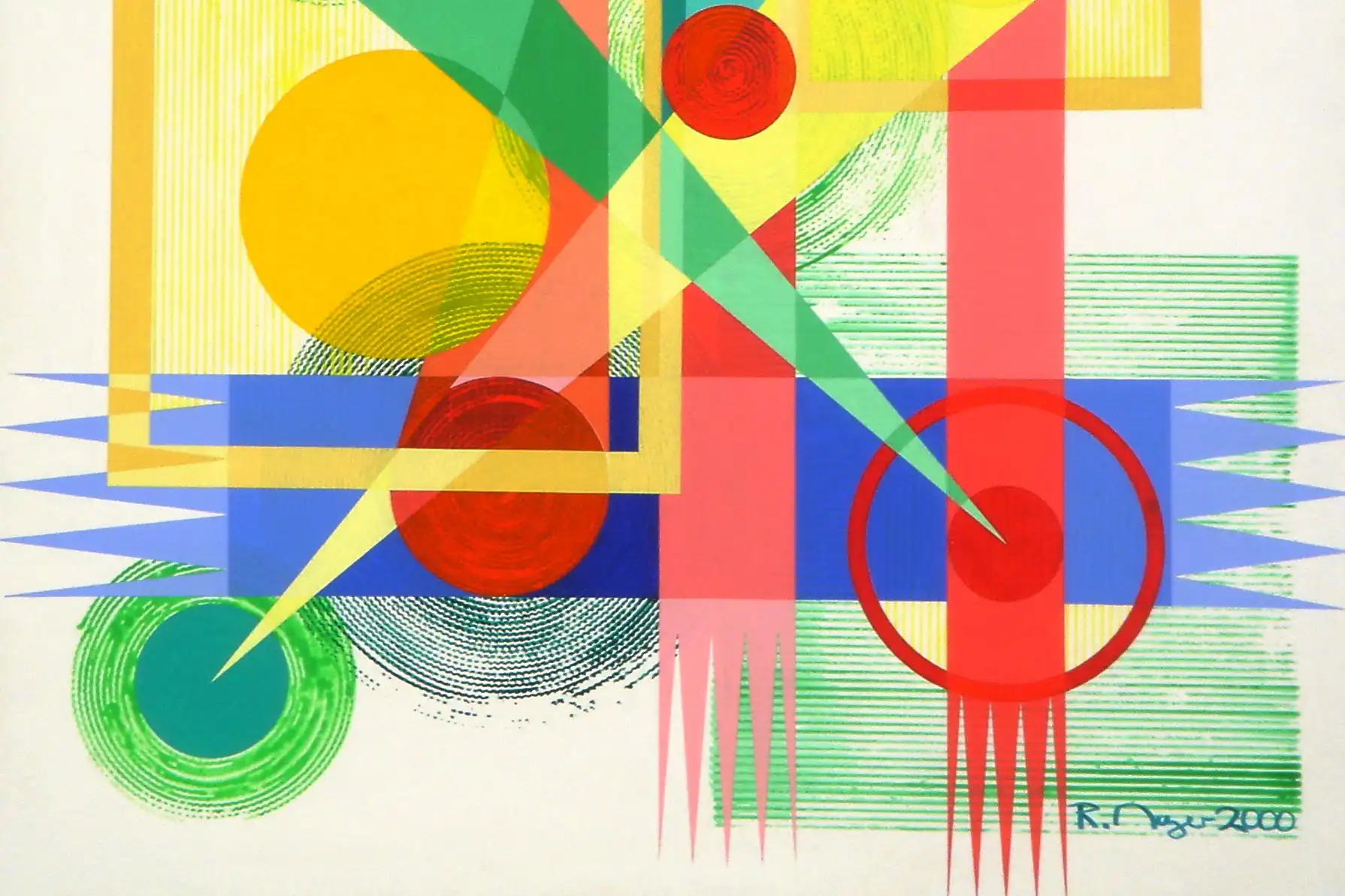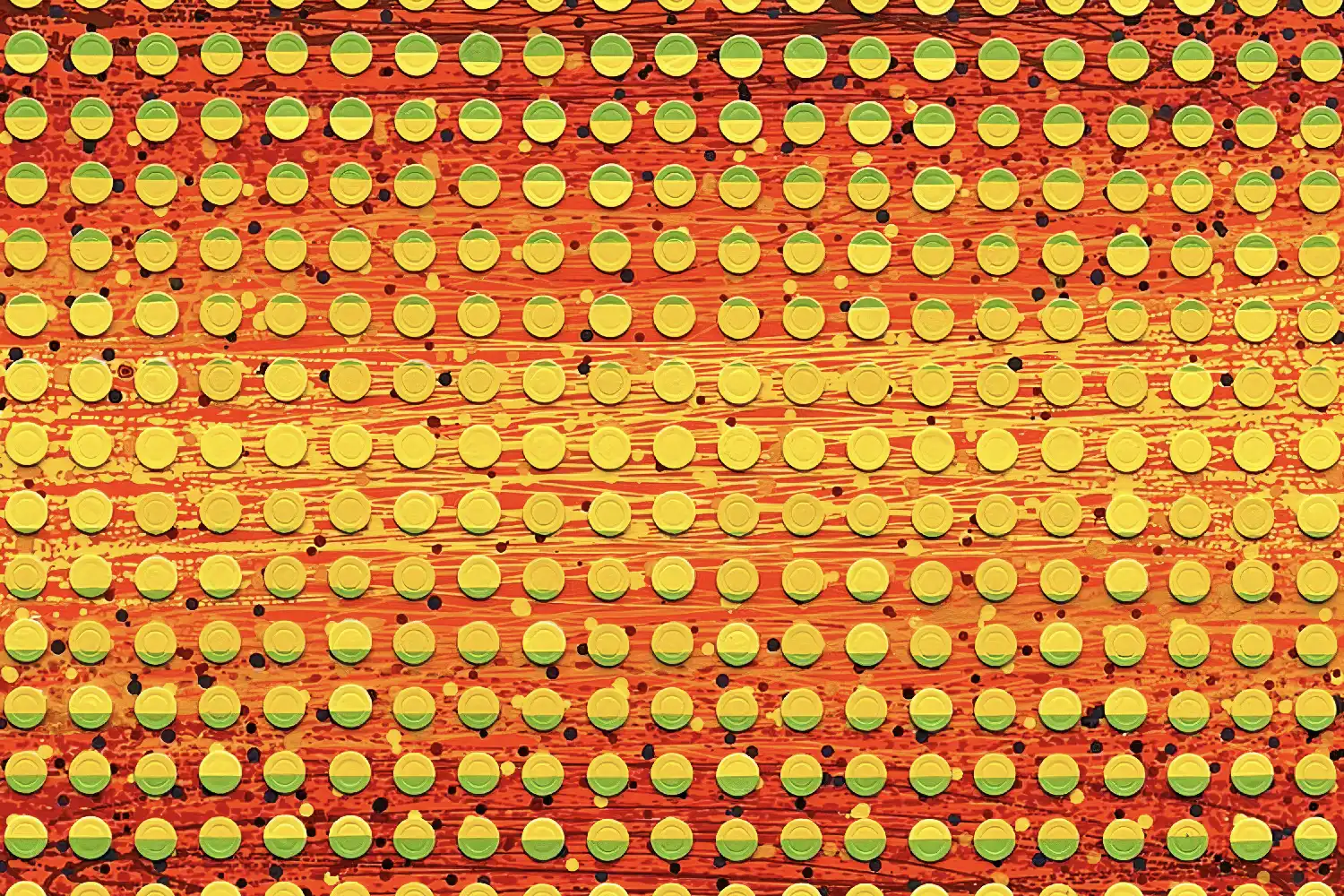L’écart des matières
Qu’est-ce qu’une sculpture contemporaine ? Cette question, en apparence simple, appelle moins une définition qu’une cartographie mouvante. Car la sculpture n’est plus une discipline bornée par un matériau noble ou un outil reconnaissable. Elle est aujourd’hui traversée par une multitude de pratiques, d’approches et de gestes qui bousculent ses fondements traditionnels. Les artistes manipulent le bronze ou le chewing-gum, le marbre ou le métal rouillé, la terre glaise, la résine, la cendre, le textile, le sucre ou l’air lui-même. Ce n’est plus la stabilité du matériau qui fonde l’œuvre, mais ce que l’artiste en fait : la manière dont il le met en jeu dans un espace d’attente, d’interruption, de contact ou d’instabilité.
Chez Rachel Whiteread, l’expérience du vide devient centrale. En moulant l’intérieur d’objets familiers — baignoires, matelas, bibliothèques ou bâtiments entiers — elle transforme l’absence en présence. ‘House’ (1993), reproduction à l’identique de l’espace vide d’une maison ouvrière de l’est londonien, est autant un geste mémorial qu’un acte sculptural. Là où la sculpture classique accumule, Whiteread inverse et soustrait.
Tony Cragg, de son côté, explore la mutation incessante des formes. Son travail, issu du recyclage dans les années 1980, a évolué vers des structures sinueuses qui semblent à la fois naturelles et artificielles. Dans ‘Forminifera’ (1993), il assemble des objets manufacturés pour constituer un ensemble organique, hybride, qui échappe à toute classification. Cragg parle d’ailleurs de ‘sculptures de la pensée’, insistant sur leur capacité à activer l’imaginaire autant que la perception.
Berlinde De Bruyckere, quant à elle, développe une sculpture qui dérange, bouleverse, redéfinit l’ordre du regard. Travaillant la cire, le bois, le cuir et des fragments de tissus, elle produit des formes humaines déformées, anonymes, mutilées. ‘Kreupelhout – Cripplewood’ (2012-13), exposée à la Biennale de Venise, présente un tronc d’arbre bandé, couvert de cicatrices, allongé comme un corps convalescent. La matière est ici blessure, vécu, mémoire charnelle. Le pathos ne vient pas d’une image, mais de la matière elle-même.
Chez Ernesto Neto, la sculpture devient immersion sensorielle. Ses installations molles, réalisées en Lycra élastique rempli d’épices ou de sable, sont suspendues au plafond, frôlées par les corps, activées par les pas. Dans ‘Leviathan Thot’ (2006), installée au Panthéon de Paris, le visiteur pénètre dans un organisme visqueux, odorant, tactile. Ici, la sculpture n’est plus un objet à voir, mais une atmosphère à traverser. Le matériau est là pour modifier le comportement du spectateur, déplacer son centre de gravité.
Cette évolution engage une redéfinition profonde de la sculpture contemporaine et de la matière. Ce qui importait hier — la durabilité, la masse, la verticalité, la noblesse du matériau — ne suffit plus. Aujourd’hui, la matière est active, résistante, symbolique, parfois éphémère. Elle devient le vecteur d’un questionnement sur le corps, le temps, la mémoire, l’espace social. Elle n’est plus un moyen au service d’une forme, mais une hypothèse à éprouver. Ainsi, la sculpture contemporaine et la matière s’entrecroisent sans cesse, dans un régime d’expérimentation où le visible n’est jamais séparé du tactile, du politique, du vivant.
Matière active – matière résistante
Depuis Richard Serra, on sait qu’une sculpture ne se contemple pas : elle déplace, elle oppose, elle oblige. Dans ‘Tilted Arc’ (1981), une immense courbe d’acier imposée dans l’espace public, l’œuvre ne se donnait ni à admirer ni à contourner sans effort. Elle exigeait une décision physique. Cette manière de ‘sculpter l’espace social’ en forçant le corps à agir, plutôt qu’à voir, redéfinit ce que peut la matière. Une sculpture ne signifie plus uniquement par ce qu’elle montre, mais par ce qu’elle provoque.
Cette logique n’exclut pas la disparition. Gianni Motti pousse cette idée à sa limite : dans ses ‘sculptures invisibles’, le matériau est aboli, remplacé par un acte ou une situation. Lorsqu’il s’attribue la responsabilité d’événements médiatiques ou qu’il traverse un lieu sans laisser de trace tangible, c’est le vide qui agit. L’œuvre est la rumeur de sa propre occurrence.
Susana Solano, de son côté, fabrique des espaces repliés, souvent en tôle d’acier oxydé. L’intérieur y est inaccessible. Ses sculptures comme ‘Interior’ (1990) paraissent proposer un abri, mais interdisent toute occupation. Elles frustrent l’usage, résistent à l’approche. C’est une matière qui exclut, mais par là même, adresse.
Erwin Wurm prend le contrepied. Il donne à la sculpture un tempo instantané. Dans ses ‘One Minute Sculptures’, le spectateur devient le matériau provisoire d’une posture absurde : allongé sur une chaise avec une courgette sur la tête, ou penché sous une table en équilibre sur une bouteille. La matière est ici comportementale. La forme est temporaire, mais son absurdité frappe, comme un éclat fugitif dans le champ sculptural.
À l’autre extrémité, Giuseppe Penone explore la lenteur. Il retire l’écorce d’un arbre pour en révéler le tronc originel, ou incruste des empreintes humaines dans des branches, des pierres ou du bronze. La matière n’est pas modelée, elle est révélée, comme si elle portait en elle l’idée de sa forme. Il ne compose pas, il expose ce qui était déjà là, en puissance.
Anish Kapoor, au contraire, travaille l’indiscernable. Dans ‘Descent into Limbo’ (1992), un trou noir d’une profondeur indéterminable ouvre littéralement le sol. Rien à toucher, rien à comprendre. Juste un vertige. La matière s’absente pour faire place à une densité optique, une incertitude géométrique.
Cornelia Parker, elle, fragmente. Sa célèbre ‘Cold Dark Matter : An Exploded View’ (1991) est la suspension minutieuse des restes d’un abri de jardin explosé, recréé dans l’espace. Chaque fragment flotte. L’œuvre est à la fois explosion, arrêt, recomposition. La matière est dispersée, mais elle tient — par la mémoire du choc.
Ainsi, dans la sculpture contemporaine, la matière n’est ni stable, ni noble, ni hiérarchique. Elle peut être manquante, molle, explosive, imprévisible. Mais elle est toujours adressée. Elle agit, résiste, blesse ou absorbe. Elle ne porte plus seulement une forme : elle est, en elle-même, l’énigme. Et dans cet usage instable de la matière, la sculpture cesse de désigner un objet. Elle devient une opération, un acte, un seuil à traverser. Voilà le territoire mouvant que dessine aujourd’hui la sculpture contemporaine et la matière.
Entrée d’une figure
Dans un paysage sculptural éclaté où la matière tend à disparaître, se fragmenter, se liquéfier ou se conceptualiser, René Mayer fait un pas de côté. Il n’en conteste pas les évolutions, il les observe. Et depuis cet écart, il choisit autre chose : revenir au geste, à la main, au volume tangible. Son point de départ n’est ni une théorie ni un protocole critique, mais un rapport sensoriel à la matière. Modeler la terre glaise, construire une forme compacte et silencieuse, y inscrire une présence, voilà son acte initial — solitaire, tactile, non spectaculaire.
Mais cet acte premier, personnel, se prolonge. René Mayer ne s’arrête pas à l’objet modelé. Il confie ses maquettes à des ateliers spécialisés, capables de transposer en marbre ou en granit ces volumes nés de l’intuition. Il ne taille pas la pierre, mais il dirige les tailleurs de pierre. L’œuvre change d’échelle, change de main, change de résistance. Ce n’est plus l’œuvre d’un seul, mais d’un processus collectif. À l’origine : une intuition fragile. À l’issue : une forme stable, durable, souveraine. Ce passage, d’un modèle d’atelier à une forme monumentale taillée dans la matière noble, interroge la notion même d’auteur.
Alors que penser de cette œuvre ainsi déployée ? La statuette est-elle déjà une œuvre d’art en soi, ou un outil de travail ? La pièce finale, produite par d’autres mais sous sa direction, est-elle encore sculpture, ou déjà design ? René Mayer ne tranche pas. Il revendique les deux régimes. Il veut créer sans contrainte, dans la liberté du moment, mais aussi inscrire ses formes dans une continuité de matière, de durée, de lisibilité. Ce qu’il invente seul, il accepte de le faire achever par d’autres. Ce qu’il modèle d’instinct, il accepte de le faire persister selon une logique artisanale.
Dans la série « Marbre & granit », cette logique atteint un point de bascule. Les pièces, taillées avec une précision qui évoque l’orfèvrerie monumentale, pourraient parfaitement s’inscrire dans un processus de production en série. L’idée de reproductibilité est là, en puissance. Et pourtant, chaque sculpture conserve la singularité de son origine : une forme trouvée, non programmée. C’est cette ambivalence qui rend le travail de René Mayer si difficile à classer : il relève autant d’une économie artisanale que d’une logique de design, autant d’un imaginaire de l’unique que d’une pensée de la série.
À l’opposé, la série « Viva Viva » relève d’une démarche inverse. Ici, rien ne passe par l’atelier ou la reproduction. Chaque sculpture est façonnée, peinte, achevée par René Mayer lui-même. Terre cuite, couleurs vives, formes ludiques et instinctives. Ce sont des œuvres immédiates, entières, closes. Elles ne transigent pas. Là où « Marbre & granit » se construit dans la délégation maîtrisée, « Viva Viva » ne se délègue pas. La main de l’artiste est partout, dans chaque courbe, chaque accident, chaque éclat de couleur.
Cette tension entre deux régimes de travail — collectif et individuel, accrétif et immédiat, artisanal et artistique — ne cherche pas à être résolue. Elle structure l’ensemble de l’œuvre sculpturale de René Mayer. Et c’est peut-être là sa singularité : assumer une position ambiguë, à la croisée de l’art et du design, sans jamais réduire l’un à l’autre. Il n’y a pas de pureté ici. Il y a une pensée plastique fluide, qui accepte de se transformer sans se perdre, de négocier sans se dissoudre.
Deux familles – un même souffle
Les deux grandes séries sculpturales de René Mayer, « Viva Viva » et « Marbre & granit », incarnent une polarité apparente — et une unité plus profonde. L’une s’élabore dans un régime d’immédiateté, de jeu, de vitalité chromatique ; l’autre dans une lenteur maîtrisée, un rapport frontal à la masse, à l’équilibre, à la coupe. Le contraste saute aux yeux : d’un côté, des sculptures colorées, façonnées à la main, en terre cuite, peintes à l’acrylique, aux formes dynamiques et expressives. De l’autre, des volumes sombres ou clairs, polis, taillés dans le marbre noir ou le granit vert, selon une géométrie silencieuse et stable.
Et pourtant, « Viva Viva » et « Marbre & granit » ne sont pas deux œuvres, mais deux modalités d’un même souffle plastique. Ce qui les lie n’est ni le style, ni le format, ni même la méthode, mais une attitude. René Mayer ne cherche jamais l’effet, il cherche la présence. Dans les deux cas, il s’agit de faire surgir une forme qui s’impose par sa signification autant que par sa facture – et cela non comme un message, mais comme un corps dans l’espace.
Paolo Bonfiglio parle justement de ‘sculptures céphalopodes, sans bouche mais avec un regard immense’. C’est une expression heureuse, qui dit bien le paradoxe : ces œuvres ne nous parlent pas, mais elles nous regardent. Elles n’ont ni visage ni intention, mais elles s’adressent à nous. Ce regard — ou plutôt cette exposition muette — renvoie à ce que Georges Didi-Huberman appelle le ‘visuel pur’, ce moment où l’image (ou ici la forme) ne sert plus à voir autre chose, mais nous oblige à voir ce qu’elle est, là, en face de nous.
Dans « Viva Viva », chaque sculpture est unique, non reproductible, non retouchée. René Mayer travaille la terre comme un peintre son esquisse : vite, directement, avec concentration. Certaines pièces évoquent des jouets archaïques, des animaux totémiques, des figures ludiques. D’autres, comme ‘The transparent eye, Meeting Point of Two ou Piercing Glaze’, sont plus abstraites, mais conservent une dynamique interne, un mouvement arrêté en plein vol. Il ne s’agit pas de symboles, mais d’organismes. Leur couleur n’est pas décorative : elle accentue la perception du volume, la tension entre intérieur et extérieur, surface et densité.
La série « Marbre & granit », elle, procède par cristallisation. René Mayer modèle une petite sculpture en terre glaise, puis délègue sa réalisation monumentale à des ateliers spécialisés en Inde. Le processus est lent, technique, rigoureux. Les pièces obtenues — ‘The Egoist, Holy Moly, The Physicist’ — ne cherchent pas à impressionner par la taille ou la matière, mais à stabiliser une forme pensée. Elles s’offrent à la lumière, à la pluie, à la durée. Leur silence n’est pas retrait : il est persistance. Comme l’écrit Jean-Luc Nancy, ‘ce qui fait œuvre, c’est ce qui tient, ce qui résiste à disparaître dans le flux’.
Ce dialogue entre création immédiate et transposition différée, entre acte intime et objet collectif, est au cœur de la sculpture contemporaine et la matière telle que l’explore René Mayer. Il ne cherche pas à fusionner les deux régimes, il les laisse coexister, comme deux voix parallèles. L’une dit l’instant, l’autre la permanence. L’une engage le geste, l’autre la matière. Mais toutes deux cherchent la même chose : une forme juste, qui tienne, qui tienne bon, sans se justifier.
Dans ce double parcours, René Mayer rejoint à sa manière la réflexion d’Henri Focillon dans Vie des formes : ‘La matière est une puissance. Elle n’est pas là pour être domptée, mais pour être comprise.’ C’est dans cet esprit qu’il travaille. Non pour imposer, mais pour écouter la forme apparaître. Une forme à la frontière de l’art et du design, ni sculpture classique, ni objet fonctionnel — mais qui matérialise ce moment d’équilibre fluctuant où quelque chose prend soudainement corps.
Archétypes et fragments
Les formes sculptées par René Mayer n’imitent rien, mais elles évoquent beaucoup. Elles ne sont pas figuratives, mais elles ne sont pas abstraites au sens moderniste. Elles appartiennent à un territoire intermédiaire, fait de réminiscences, d’associations, d’allusions. Elles ne montrent pas le corps, elles en conservent la mémoire. Une tête sans visage, une silhouette sans sexe, un buste fendu, un œil sans orbite : ces fragments ne racontent pas une chute, mais une persistance. Ils n’expriment ni douleur ni exaltation, mais une sorte d’endurance muette. Ils sont là, comme des présences surgies de l’avant-image, comme si la sculpture contemporaine et la matière retrouvaient ici le pouvoir de faire apparaître sans montrer.
Cette tension n’est pas nouvelle. On la trouve chez Germaine Richier, dans ses corps transitoires entre végétal, animal et humain. Chez Jean Fautrier, dans ses ‘Otages ravinés’. Chez Magdalena Abakanowicz, dans ses foules d’individus sans visage, debout, anonymes. Mais chez René Mayer, la charge symbolique est tenue à distance. Il n’y a ni pathos ni discours. La déformation n’est pas souffrance, elle est évidence. L’inachèvement n’est pas une faiblesse, c’est une forme.
Dans ‘The Egoist’, bloc compact à la tête globuleuse, le regard est une absence creusée. Dans ‘Holy Moly’, verticalité stricte entaillée de niches, la forme semble attendre une voix qui ne viendra pas. Dans ‘The Other Side’, deux moitiés de figures semblent se faire face sans jamais se rejoindre. Ces sculptures ne renvoient pas à un mythe, mais à une condition : être là, debout, sans justification.
Henri Focillon écrivait que ‘toute forme vit sa vie propre, indépendante de ce qu’elle peut représenter’. René Mayer semble avoir pris ce postulat au pied de la lettre. Chaque forme qu’il crée est une entité, une unité autosuffisante, mais poreuse. Elle ne raconte rien, mais elle laisse passer une relation. La forme n’est pas un contenant, c’est un contact.
La posture, la frontalité, l’équilibre interne de ses sculptures évoquent des archétypes : non pas des symboles universels, mais des configurations archaïques, préverbales. Ce ne sont pas des statues, ce sont des figures. Des formes debout, regardant sans voir, nommables sans nom. Leur mutisme est actif. Elles nous obligent à rester devant elles, dans cette zone d’incertitude que Didi-Huberman nomme ‘présence pure’.
En ce sens, René Mayer ne cherche pas essentiellement à créer des œuvres lisibles. Il cherche des formes qui durent. Non pas dans la matière seulement, mais dans le regard. Comme si chaque sculpture, plutôt que d’être offerte, était en attente : attente d’un sol qui la fixe, d’un ciel qui l’éclaire, d’un corps qui lui réponde. Elles ne tombent pas du ciel, elles montent depuis l’obscur. Ce sont des fragments d’humanité — non dans leur défaite, mais dans leur obstination.
Le lieu comme extension de la forme
Installées dans les collines du Piémont, posées à même l’herbe, entre les arbres ou les pierres, les sculptures de René Mayer ne semblent pas ‘exposées’ mais simplement présentes. Elles ne sont pas là pour être vues, mais pour habiter, pour coexister avec la lumière, les saisons, les mousses, les insectes – et les gens. Le temps ne les abîme pas : il les polit. Il ne les efface pas : il les inscrit. Comme ‘Reine et Roi’ de Henry Moore installés à Dumfries dans un écrin naturel, les formes de René Mayer trouvent leur terroir, leur seuil, leur sol. Elles ne cherchent pas un piédestal, mais un ancrage.
Cette relation au lieu est d’autant plus forte que ses sculptures n’imposent rien. Elles se glissent dans l’environnement, elles l’écoutent. Le marbre vert sombre devient mousse. Le granit prend la lumière comme une eau stagnante. La matière se fait modeste, opaque, et c’est cette discrétion qui agit. Contrairement à tant d’œuvres contemporaines qui colonisent l’espace, René Mayer laisse ses sculptures s’ajuster, sans plan, sans système. Elles se déposent. Elles prennent leur place par retrait.
Ce rapport de respect — ou d’humilité — n’est pas sans lien avec la manière dont certaines de ses formes ont vu le jour. Dans la série « Viva Viva », inspirée des statuettes polychromes mexicaines, les sculptures en terre cuite peintes évoquent, sans jamais les copier, les masques du carnaval de Bâle. René Mayer connaît ces figures depuis l’enfance. Il les a observées, portées, affrontées dans les rues et les confettis. Leur disproportion, leur bouche béante, leurs couleurs vives, leur pouvoir grotesque mais toujours maîtrisé ont laissé une empreinte. Mais chez lui, rien n’est citation directe : ce sont des rémanences. Ce n’est pas le masque qui est repris, c’est l’attitude, le surgissement, l’énergie condensée dans une tête sans cou ou un œil décalé.
Ce qui les relie — ces masques carnavalesques et les sculptures de René Mayer —, c’est ce que Bakhtine appelait la ‘corporéité festive’ : cette manière qu’a le corps grotesque d’être en transformation, en débordement, en contact permanent avec son monde. Chez René Mayer, la sculpture ne clôt rien. Elle reste ouverte, poreuse, en suspens. Elle n’érige pas un monument, elle invente une place.
En ce sens, les sculptures de René Mayer appartiennent autant au paysage qu’à l’histoire du volume. Elles ne tracent pas une lignée, elles creusent une niche. Une manière d’être au monde par la forme, une forme qui ne cherche pas à briller, mais à rester. Et dans cette manière de s’installer — sans discours, sans emphase —, la sculpture contemporaine et la matière trouvent une possibilité de durée qui ne s’oppose pas au vivant, mais qui s’y accorde.
Conclusion – Une forme d’insistance
Dans une époque dominée par l’obligation de célérité, la circulation des signes, la volatilité des images, l’œuvre sculpturale de René Mayer propose une forme de résistance silencieuse. Non pas une opposition théorique ou critique, mais un refus calme de suivre le rythme. Il n’y a rien à démontrer, rien à illustrer, rien à commenter. Juste une forme qui persiste, une présence qu’il faut soutenir — physiquement, mentalement, temporellement. La sculpture contemporaine et la matière ne sont pas pour lui des catégories à thématiser, mais un terrain d’expérience, un champ d’attention.
Ce que René Mayer oppose à l’éphémère, ce n’est pas le monumental : c’est la consistance. Pas la lourdeur, mais la pesanteur. Pas la solennité, mais la densité. Ses sculptures, même les plus colorées, ne cherchent pas l’œil, elles cherchent un havre. Même ses pièces les plus ludiques — les « Viva Viva » aux formes lisses et presque dansantes — émargent à cette même nécessité : modeler, déplacer, recommencer, faire tenir. On y retrouve la lissitude du bois flotté, la plasticité d’un souvenir, la liberté improvisée d’un masque de carnaval, mais sans anecdote. C’est une fête sans bruit, une apparition sans spectacle.
Dans les « Marbre & granit », cette volonté prend la forme d’un passage : de la main solitaire à la main collective, du modelé au poli, de l’atelier à la manufacture. La question n’est plus celle de l’auteur, mais de la forme qui se stabilise sans perdre sa singularité. Dans un monde où tout peut être produit, publié, reproduit, René Mayer garde le geste initial comme point d’ancrage. Et même quand l’œuvre est reprise, amplifiée, transposée, elle reste reliée à ce geste-là.
Il y a chez lui quelque chose qui relève de l’artisanat profond, au sens où l’entendait Richard Sennett : ‘un engagement attentif dans le processus de fabrication, qui oblige à ajuster son corps, son esprit, et son temps à ce qu’on est en train de faire.’ René Mayer ne théorise pas. Il travaille. Il sculpte, il ajuste, il oriente, il regarde. Ce qu’il laisse derrière lui, ce sont des formes qui ont traversé l’épreuve de la matière et du regard – qui entrent dans la durée.
Ainsi, ce que propose René Mayer n’est pas un message sculptural, mais une forme d’insistance : une manière d’exister dans la durée, sans emphase. Défaire l’éloquence, réaffirmer la gravité des formes. Ne pas suivre le flux, mais y inscrire un seuil — quelque chose qui ne passe pas, qui oblige à demeurer.