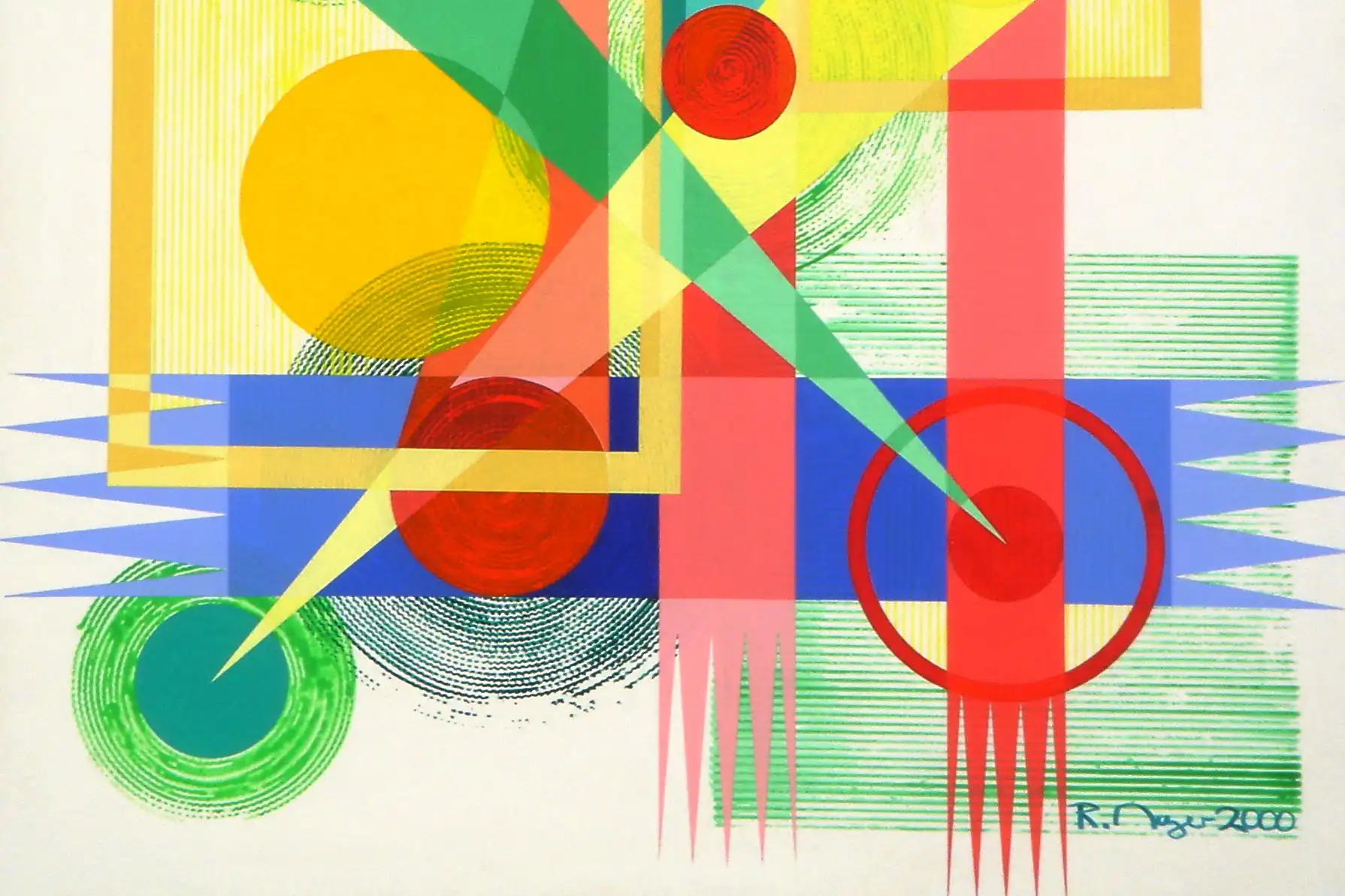René Mayer (1947) est né et a grandi en Suisse allemande, dans la région bâloise. Bâle, troisième ville suisse, jouxte l’Allemagne et la France sur ce grand axe fluvial qu’est le Rhin. La ville, industrieuse et studieuse, commerçante et florissante, est réputée très tolérante. Le cosmopolitisme de René Mayer a donc de solides racines. Mais ce n’est pas tout !
Les origines d’une passion
René Mayer fait partie de ces optimistes indécrottables qui affirment que les obstacles sont faits pour être vaincus. Ce qu’il entreprend, il le développe avec passion et le mène à chef avec détermination. Très jeune, il affichait déjà un fort besoin d’autonomie et une solide volonté de succès. La preuve : alors qu’il n’était encore qu’un gamin en scolarité primaire, il s’improvisa avec succès promeneur de chiens (jusqu’à six à la fois !) pour arrondir le maigre argent de poche que ses parents lui octroyaient. Plus tard, à l’adolescence, il mena en un temps record le groupe d’éclaireurs dont on lui avait confié la responsabilité de la dernière à la première place du classement des scouts bâlois… – Bref, aucun défi ne le rebute, mais tous le stimulent. Aujourd’hui encore – et à coup sûr demain aussi !
Cet esprit précocement entrepreneurial se développe au fil des ans jusqu’à culminer dans la fondation, dans les années 70, d’une bientôt florissante entreprise commerciale dédiée aux arts de la table – mais ça, c’est une autre histoire. Ayant acquis grâce à cette firme l’autonomie financière souhaitée, René Mayer a pu se consacrer plus librement que ses amis artistes, dont il avait parfaitement mesuré et compris les angoisses et problèmes existentiels, à son activité picturale et plastique.
Touche-à-tout rebelle
Le corollaire et le préalable de cette activité sans bornes ni pause, c’est la curiosité innée, quasi-insatiable de René Mayer. Pour lui, rien n’est a priori inintéressant – surtout pas dans le domaine culturel. Il a été très tôt passionné par l’art sous toute ses formes, découvrant par exemple avec étonnement et enthousiasme l’architecture organique hors norme du Goetheanum de Rudolf Steiner et des bâtiments qui l’entourent, à Dornach. La rupture culturelle induite et symbolisée par les concepts architecturaux de Steiner (dont il ne partage pas la conception anthroposophique du monde) le séduisit, car elle vibrait à l’unisson d’une corde particulièrement sensible de son caractère : l’esprit rebelle.
Rebelle, René Mayer l’est depuis son enfance. Mais sa rébellion n’est jamais un geste d’opérette, une opposition de principe ou d’opportunité. Lorsqu’il se révolte, c’est par conviction, parce qu’il est confronté à une situation injuste, abusive, arbitraire, idiote, inique. Et là, il se bat pour les autres comme pour lui sans se soucier des pertes. C’est cette tournure d’esprit libertaire, cette volonté de rompre avec le conformisme ambiant qui l’a incité très tôt à devenir artiste – évidemment au grand dam de ses parents, qui eussent préféré le voir embrasser une carrière résolument bourgeoise !
Un produit du terroir…
René Mayer est un vrai produit du terroir ! Son éclectisme et son libéralisme plongent leurs racines dans un microcosme socio-culturel bâlois nourri des trois humanismes ayant imprimé leur marque à la région – l’allemand, le français et le suisse – et sur lesquels s’est développée au fil des siècles la grande tradition de tolérance qui a permis à de grands esprits européens, parfois persécutés et souvent méconnus ailleurs, de s’épanouir au bord du Rhin. Mais si la ville a été un port accueillant pour les intellectuels que furent Erasme, Jean Œcolampade et Leonhard Euler, elle a aussi été un havre pour des artistes aussi réputés qu’Arnold Böcklin, Pipilotti Rist ou Jean Tinguely – un Jeannot que René Mayer apprécie particulièrement et auquel la cité voue une vénération quasi-idolâtre… Et n’oublions pas la culture dite « alternative », pour laquelle Bâle et sa région ont toujours été un terreau nourricier ! Dans ce monde très particulier, patricien et cossu, mais également discret et cultivé, l’argent et la culture se croisent et font bon ménage. Les fabuleuses collections privées léguées où prêtées aux musées bâlois l’attestent aussi clairement que la célèbre exposition annuelle Art Basel, qui draine artistes et galeries du monde entier dans la cité rhénane.
Habitant aux marches du canton, René Mayer est un assidu de la Fondation Beyeler et des institutions culturelles régionales. Lorsqu’il « ausculte » les tableaux de Mark Rothko dans la pénombre bien dosée du magnifique bâtiment créé par Renzo Piano, lorsqu’il redécouvre l’œuvre de vieillesse de Paul Klee dans une somptueuse rétrospective, lorsqu’il suit à la trace Paul Gauguin dans sa vie et son travail, au gré des pérégrinations géographiques et artistiques du peintre, ou lorsqu’il vibre dans le vent qui caresse les arbres emballés par Christo et Jeanne-Claude dans le parc de la Fondation, il n’est jamais rassasié, jamais saoulé – jamais blasé.
Entre exubérance et rationalité
Nous avons évoqué l’attrait que l’architecture organique du Goetheanum exerçait sur René Mayer. Mais ce goût pour les formes biomorphes n’est que l’un des pôles de sa sensibilité artistique. L’autre, c’est sa prédilection pour la simplicité et le dépouillement, tels que prônés dès les années 1920 par une académie qui deviendra mondialement célèbre : le Bauhaus de Walter Gropius, ouvert en 1919 à Weimar, transféré en 1925 à Dessau et démantelé en 1933 à Berlin-Steglitz en réponse aux pressions exercées par les autorités nazies. Dans cette institution, la recherche et l’enseignement se sont d’abord concentrés sur la revalorisation de la fonction artisanale dans l’art. Ensuite est venue la réflexion sur la simplification des formes des biens de consommation courante. Qu’il s’agisse de salières, de théières, de lampes de chevet, de papiers peints ou de meubles – essentiellement des sièges et des sofas –, pour ne citer que quelques exemples, la stylique héritée du siècle précédent était fondamentalement remise en question. Dans l’esprit des « maîtres » (comme on appelait les enseignants du Bauhaus), la finalité de la simplification des formes était à la fois industrielle (créer des objets qui se laissent produire très rationnellement) et esthétique (créer de beaux objets). Cette réflexion a culminé dans le concept du « moins c’est plus », donc dans le refus de toute ornementation superfétatoire – un concept qui était aussi la devise de l’architecte et designer germano-américain Ludwig Mies van der Rohe, l’un des « maîtres » les plus influents du Bauhaus. Mies van der Rohe a joué un rôle déterminant dans la propagation mondiale de l’esprit du Bauhaus. Le fameux pavillon allemand de l’Exposition universelle de Barcelone de 1929, qu’il a conçu avec Lilly Reich, et la chauffeuse (fauteuil) « Barcelona », créée pour ce pavillon, comptent parmi ses réalisations les plus remarquables.
Pour en revenir aux deux axes conceptuels qui guident René Mayer : un raisonnement (trop) rapide pourrait déboucher sur la présomption que l’artiste fait preuve d’une ambivalence déconcertante en embrassant simultanément deux doctrines totalement antagonistes. Mais la contradiction n’est qu’apparente. Ou, pour être précis, elle ne porte que sur l’un des aspects de la question : le style. Il va de soi que la stylique épurée du Bauhaus s’inscrit en contradiction – ou plutôt en contrepoint – du design biomorphique parfois exubérant de l’architecture organique. La question est donc : qu’est-ce qui relie le monde du Bauhaus à celui du Goetheanum ? La réponse est d’une lumineuse évidence : l’approche artisanale propre aux deux philosophies. Car l’architecture organique, qui veut se développer en symbiose avec la nature, comme le revendiquent les créations de Frank Lloyd Wright, privilégie logiquement les matériaux naturels tels que la brique, le bois et la pierre – et stimule par voie de conséquence, l’artisanat qui les met en œuvre. Steiner (il a construit le Goetheanum en béton, ne l’oublions pas… !) autant que Gropius sont parfaitement conscients de l’importance du savoir-faire artisanal. Dans ses préceptes d’enseignement, Steiner va jusqu’à dire que l’objectif des travaux manuels scolaires (aujourd’hui « arts plastiques ») n’est pas de former les élèves à une bonne maîtrise des techniques artisanales, mais de déboucher sur la création d’objets utiles et utilisables.
Donc, la conscience de l’importance vitale – au sens d’« indispensable à la vie » – de l’artisanat est le fil d’Ariane qui guide René Mayer. Lorsque celui-ci dit qu’il est au fond de son cœur un artisan, il met clairement, mais sans le verbaliser, l’accent sur la notion de vie : Le cœur, c’est l’endroit où ne bat pas seulement le pouls de la vie biologique, mais aussi celui de la vie émotionnelle. – Au fil des ans et de ses expérimentations artistiques, René Mayer a de plus en plus profondément compris et assimilé la nécessité vitale de l’acte créateur et l’importance qu’il y a à produire quelque chose de ses propres mains. C’est dans l’honnêteté et l’humilité de cette démarche que naît la flamme qui confère aux œuvres la personnalité, la légitimité et la vitalité que n’auront jamais les produits issus d’une usine située à l’autre bout du monde.
Conclusion
Plutôt que dans des antécédents familiaux, il faut rechercher les origines de la passion artistique de René Mayer dans son tempérament rebelle, en phase avec les profondes mutations sociétales des années 60 et 70, et dans le climat induit par celles-ci dans le microcosme culturel bâlois qu’il fréquentait. Ses parents faisaient certes partie de la bourgeoisie éclairée, mais ne pratiquaient pas les arts à cette époque. Ce n’est que bien plus tard que le beau-père de René Mayer (second mari de sa mère) s’est adonné à la peinture et à la sculpture, mais sans en faire une carrière.